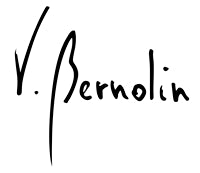Comment caractériser les Flûtes à bec

Share
Chacun a pu l'expérimenter : il est très difficile de décrire avec des mots l'expérience vécue sur un instrument, tant les sensations sont liées aux émotions ressenties, avec le manque de neutralité qui leur sont fatalement associées. Dans cet article je vais tenter de décrire les divers aspects de la sonorité et de la réponse d'une flûte à bec, non seulement par les sensations , mais également avec l'appui de mon expérience de facteur et des composantes physiques que j'ai pu mettre en relation avec ce que j'entendais. J'appelle composantes physiques les diverses quantités concrètes telles que le profil ou la largeur du canal, la taille et l'angle des chanfreins de sortie, l'épaisseur du labium, sa position relative dans la fenêtre, ou toute autre grandeur mesurable qui permettrait de caractériser le réglage du sifflet. L'intérêt de cette approche est de permettre de différencier certains aspects du fonctionnement de l'instrument qui, sans cet appui, prêtent rapidement à confusion. C'est la raison pour laquelle je vais demander au lecteur de faire preuve d'ouverture d'esprit , et de comprendre que les éléments que je vais évoquer ne sont pas seulement issus de mon imagination ou d'une perception subjective, mais sont en relation avec un certain nombre de paramètres physiques qui donnent une certaine légitimité à cette analyse.
Le couple Flexibilité / Résistance:
Se définit par la possibilité de faire varier le timbre et l'intonation en ajustant la pression d'air entrant dans le sifflet. Résistance est ici utilisé comme synonyme de stabilité. Une flûte à bec flexible va donc voir sa sonorité varier avec la pression, au contraire d'une flûte résistante qui va amortir et encaisser les variations avec davantage de stabilité. Tout est affaire de dosage en l'occurrence : une flûte très résistante peut brider l'intention musicale avec un son figé, mais un réglage trop flexible peut s'avérer trop mouvant, instable, et rendre l'expressivité recherchée incompatible avec l'intonation. Un réglage plus stable offre en outre des basses plus solides.
Les harmoniques
Sans doute un des aspects les moins bien compris de la sonorité des instruments de musique, mais c'est aussi incontestablement le plus difficile à définir. Les instruments les plus intéressants sont souvent qualifiés à tort comme riches en harmoniques. Et pourtant cette richesse est dans la physique et l'acoustique clairement associée à un instrument bruyant, à la sonorité banale et quelconque, sans aucun charme. C'est au contraire la maîtrise de l'émission de certaines harmoniques qui va permettre d'obtenir la couleur sonore recherchée, et elle ne saurait être le fruit du hasard. A ma grande surprise, j'ai pu constater que certains musiciens en font peu de cas, pas davantage que certains facteurs. Il s'agit donc sans conteste de l'élément le plus subjectif de cette étude, mais c'est aussi celui à propos duquel je ne saurais accepter de compromis.
Les attaques
La vitesse des attaques va définir la réactivité de l'instrument. De même qu'en ce qui concerne la flexibilité, cet élément doit être soigneusement réfléchi et dosé : trop de réactivité rend la flûte délicate et caractérielle, mais un excès de lenteur dans les attaques se perçoit par une inertie et une demande d'énergie excessive de la part du flûtiste.
L'ouverture
Va définir la précision et la pureté du timbre, qui ont été recherchés à une certaine période, notamment dans les années 70 et 80 avec les flûtes de Fred Morgan. On a depuis réalisé que les flûtes à bec plus ouvertes présentent une sonorité plus moelleuse, moins brillante, plus chaude, doublée d'un second registre moins perçant et agressif. C'est la direction qui a été donnée depuis les années 2000 par la génération montante des flûtistes, notamment par Dorothée Oberlinger, Erik Bosgraaf et Maurice Steger. Ce type de réglage demande davantage de débit d'air, et les flûtes exagérément ouvertes peuvent s'avérer difficiles à jouer. C'est pourquoi là aussi, un compromis est nécessaire.
Les transitoires
Les attaques, en acoustiques sont appelées "transitoires", et sont audibles en particulier sur certains tuyaux d'orgue et sur les flûtes à bec de Consort. Des transitoires marqués offrent un dynamisme certain par le côté percussif et rythmique qu'ils apportent. En contrepartie, ces attaques peuvent venir parasiter les traits et enchaînement très rapides que l'on trouvera assez souvent dans la musique Baroque, notamment dans les Concertos de Vivaldi. C'est pourquoi je réserve les attaques marquées aux flûtes à bec Renaissance, ou à la musique folklorique, et que je préfère des transitoires plus discrets pour les instruments Baroques pour lesquels je considère la nécessité d'un jeu plus net.
Le diagramme :
Vous retrouverez ci dessous le diagramme qui synthétise les éléments que je viens d'évoquer : vous pourrez noter que j'ai mis en opposition les deux extrêmes de chaque point considéré, pour mieux illustrer le propos. Ce diagramme m'est utile pour caractériser l'influence de chaque paramètre que je place en regard sa zone d'influence. Il n'est en revanche pas destiné à cartographier un instrument, comme vous allez pouvoir le découvrir plus bas.

Vous trouverez ci dessous un autre type de diagramme qui reprend les éléments évoqués en leur donnant une note de 0 à 5. Si ce barème est contestable, notamment en ce qui concerne les transitoires pour lesquels une note de 5 n'est pas forcément la meilleure, il a le mérite de permettre d'appréhender visuellement et plus facilement le type de réglage proposé. Comme vous allez pouvoir le constater, la comparaison entre les instruments est grandement facilitée par ce style de représentation graphique.
Flûtes ouvertes ou flexibles : Ernst Meyer et Fred Morgan
Dans les années 70 et 80, comme cité plus haut, Fred Morgan trouve un consensus avec un réglage assez peu ouvert, une sonorité pure et précise, beaucoup de flexibilité et de souplesse dans le son, des aigus très rapides et faciles et un registre grave peu puissant.

A l'inverse dans les années 2000, Ernst Meyer propose aux flûtistes un réglage très ouvert, avec une sonorité plus chaude et moelleuse, des basses puissantes et très stables, avec en contrepartie un registre aigu qui demande des attaques extrêmement énergiques et une grande vitesse d'air.

Comment se situent les flûtes Bernolin ?
Résistance : je considère qu'il est nécessaire de laisser une certaine latitude au musicien, et de fait une certaine flexibilité à l'instrument, mais je surveille en particulier l'absence de saturation dans les mediums et la solidité des basses.
Harmoniques : l'élégance sera toujours le fil d'Ariane de mon travail. Mon objectif est de produire autant qu'il est possible des instruments qui sortent de l'ordinaire.
Ouverture : le réglage que je réalise aujourd'hui est plutôt ouvert, mais je reste conscient des limites pneumatiques de la machine humaine, et le débit d'air exigé reste raisonnable et accessible.
Attaques : je vais clairement dans la direction d'un instrument réactif avec des attaques plutôt rapides. Je considère que c'est un atout en termes de facilité de jeu. En contrepartie, la vitesse d'air à l'attaque est à contrôler dans le registre grave et pour les notes structurellement délicates comme le Do # aigu de la flûte à bec Alto. Je reste convaincu par le confort de jeu et les possibilités musicales qu'offre cette approche.
Transitoires : davantage marqués pour les Ganassi et Van Eyck, je préfère en revanche plus de souplesse dans les articulations pour les flûtes Baroques. Dans tous les cas, le transitoire ne doit pas devenir un fardeau pour le musicien ou venir brouiller le discours musical.